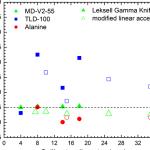Résumé de l’exposé
Malgré ces quelques réformes substantielles, leur structure apparaît archaïque. s’ils ne sont plus des impôts de répartition, ils sont toujours assis sur des bases qui n’entretiennent pas de relations adéquates avec la réalité économique et la justice fiscale. En effet, cette idée de justice fiscale est un idéal. Mais dans la réalité, elle se manifeste par le souci d’une équitable répartition de l’impôt entre les citoyens en raison de leurs facultés contributives, ce qui sous entend l’absence d’immunité fiscale et l’universalité de l’impôt. Pour réaliser cette proportionnalité aux facultés contributives, il sera nécessaire de personnaliser l’impôt, c’est à dire de tenir compte du statut familial du contribuable lors de l’établissement du prélèvement, et d’aménager sa contribution en fonction de sa situation financière d’ensemble.
Or, on ne retrouve aucun de ces éléments au niveau de la fiscalité locale. Il semble que la fiscalité locale soit très injuste, que se soit au niveau politique ou économique
Sommaire de l’exposé
- Une fiscalité injuste à l’égard des contribuables
- Une fiscalité locale injuste car non progressive
- Une fiscalité locale impersonnelle
- Une fiscalité locale injuste à l’égard des collectivités territoriales
- Une FL injuste car génératrice d’inégalités entre les CT
- Une fiscalité locale génératrice d’asymétries avec l?Etat
Extraits de l’exposé
[. ] Le principe général est celui du plafonnement des taux. En cas de variation proportionnelle ou différenciée, les taux font l’objet d’un plafonnement glissant. le taux de la TP n’excède pas deux fois le taux moyen national de l’an passé. Ceux de la TH. TFNB et TFB sont plafonnés à deux fois et demie la moyenne nationale précédente.
De même, les taux sont liés, avec par exemple, en cas de variation différenciée le taux de la TP ne peut augmenter ou diminuer moins que celui de la TH. [. ]
[. ] Mais ces inégalités fondamentales sont encore accentuées par le mode de calcul actuel de la FL, mais aussi par une solidarité fiscale source d’injustices. Inégalité des ressources entre CT En effet, la richesse des CT (notamment des communes) peut être appréhendée à partir du revenu des habitants et du potentiel fiscal (montant des bases taxables par habitant). Comme l’impôt local frappe conjointement les résidents et les entreprises, les deux indicateurs ne coïncident plus. La fiscalité directe communale provient ainsi pour 53% des activités économiques et 47% des logements. Cependant, l’inégale concentration spatiale des entreprises explique 90% des disparités de potentiel fiscal. [. ]
[. ] Mais dans la réalité, elle se manifeste par le souci d’une équitable répartition de l’impôt entre les citoyens en raison de leurs facultés contributives, ce qui sous entend l’absence d’immunité fiscale et l’universalité de l’impôt. Pour réaliser cette proportionnalité aux facultés contributives, il sera nécessaire de personnaliser l’impôt, c’est à dire de tenir compte du statut familial du contribuable lors de l’établissement du prélèvement, et d’aménager sa contribution en fonction de sa situation financière d’ensemble. Or, on ne retrouve aucun de ces éléments au niveau de la fiscalité locale.

Il semble que la fiscalité locale soit très injuste, que se soit au niveau politique ou économique. [. ]
[. ] Une solidarité fiscale paradoxalement source d’injustices L’objectif de ces mécanismes de péréquation fiscale est de favoriser une harmonisation de l’espace local, une redistribution des richesses et une réduction des inégalités. Cela représente également un contrepoids à la compétition entre les CT et un facteur de régulation du système local. Cela permet alors de restructurer le réseau financier local. C’est cette conception que le législateur semble avoir consacré au travers de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003. (alinéa 5 de l’art 72-2). [. ]
[. ] Cette centralisation fiscale s’identifierait à une forme de subvention. C’est en outre la solution préconisée par le 15ème rapport du conseil des impôts de 1997 qui propose une TP transformée en un impôt national, redistribué aux CT sous forme de dotation, une sorte de mutualisation de cet impôt. De même, il existe un argument économique qui vise à éviter les distorsions de concurrence et les délocalisations injustifiées des entreprises ou des ménages. C’est alors cette logique qui pourrait prévaloir si la réduction de l’assiette de la TP aux seules immobilisations de capital rendait le fonctionnement de cette taxe trop complexe et trop illogique. [. ]
À propos de l’auteur
Julien P. étudiant Droit fiscal
La fiscalité locale est-elle juste.
Niveau Expert Etude suivie sciences. Ecole, université Sciences Po.
Descriptif de l’exposé
Date de publication 2006-03-23 Date de mise à jour 2006-03-23 Langue français Format
Type dissertation Nombre de pages 6 pages Niveau expert Téléchargé 39 fois Validé par le comité de lecture
La fiscalité locale est-elle juste.


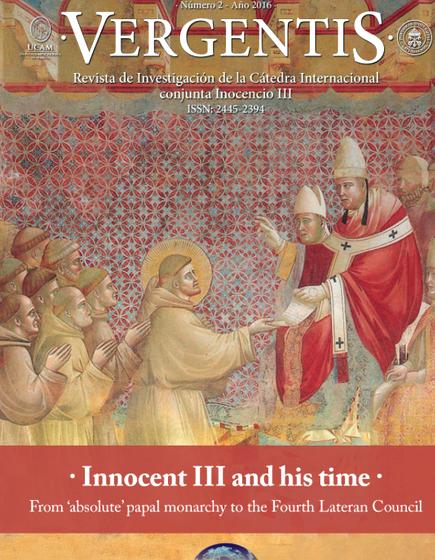


 Thesis proposal sample apa style
Thesis proposal sample apa style Pfn vs dhs thesis proposal
Pfn vs dhs thesis proposal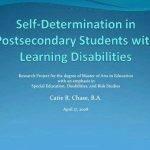 Master thesis proposal sample ppt presentation
Master thesis proposal sample ppt presentation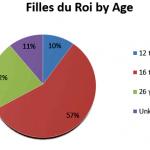 Jms careless metropolitan hinterland thesis proposal
Jms careless metropolitan hinterland thesis proposal Write contents page dissertation proposal
Write contents page dissertation proposal