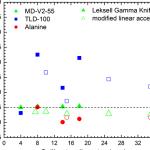La note :
Moyenne des notes : (basée sur 4 avis)
Cote pondérée : (20 568ème position).
Visites : 2 205
Roman social
La réalisatrice du film “Le ring” attaque ici son premier roman. Elle y aborde encore ce thème qu’elle connaît bien. les enfants négligés d’Hochelaga-Maisonneuve.
Roxane, Kevin et Mélissa vivent tous les trois dans le même bloc. Ils partagent aussi la même classe “d’orthos” à l’école du quartier. Chacun à sa manière, ils se débattent dans la misère qui fait leur quotidien. Roxane s’évade à la bibliothèque pour oublier les beuveries de sa mère; Kevin se défoule sur ses jeux vidéo après l’école; Mélissa fait ce qu’elle peut pour cacher à la DPJ qu’elle n’a plus personne pour s’occuper d’elle et de ses petits frères.
C’est un roman écrit en langue parlée, pour ne pas dire en joual. Le langage ajoute encore de l’authenticité au propos; sous la plume de l’auteure, les personnages, les dialogues et le quartier en général prennent vie pour le lecteur. L’auteure dénonce une réalité qui existe et dont on n’entend pas assez parler, et elle le fait de façon habile. On les plaint, ces enfants, mais on plaint aussi leurs parents. Il n’y a pas de coupable dans ce livre, si ce n’est de la misère et de la pauvreté qui semblent se transmettre de génération en génération.
Mais il y a tout de même un bémol. On nous annonce un roman sans pathos, mais je ne suis pas tout à fait d’accord avec ce fait. Certaines scènes semblent mises en place expressément pour émouvoir le lecteur, ce qui m’a dérangée un peu. À certains moments, j’aurais préféré que l’auteure s’en tienne au minimum. La misère est déjà triste, il n’y a nul besoin de zoomer sur la souffrance.
La tristesse du regard des enfants de la détresse est un métalangage qu’interprète Anaïs Barbeau-Lavalette avec les mots bafoués d’une vie « ben mal emmanchée».
Mal fichue, dirait-on de l’autre côté de la grande mare.
Sans les juger et sans susciter la pitié, Anaïs Barbeau-Lavalette décrit tout simplement le quotidien de petits Montréalais de l’arrondissement Hochelaga, qui fréquentent une « classe d’orthos » composée par des élèves qui ont soi-disant des troubles d’apprentissage. Des TA qui cherchent l’ivresse de vivre malgré la rudesse de leur existence. Ce ne sont pas les enfants rois des familles de l’aisance, ce sont ceux de la résilience. Ils portent sur leurs frêles épaules des responsabilités d’adultes. Ils sont presque les parents de leurs géniteurs.
Le seul expédient pour survivre reste la prostitution. La situation creuse une distance entre les génitrices et leur progéniture. C’est d’autant plus difficile lorsque, chaque jour pour se rendre à l’école, il faut franchir la barrière qu’elles érigent dans la rue Ontario afin de relever le client potentiel. Ce ne sont pas des mères dénaturées. Elles ont épuisé toutes leurs ressources. Pourtant, elles aimeraient bien être à la maison pour cuisiner le fameux pâté chinois pour leurs enfants qu’un rien met en liesse.
(recettes.qc.ca/recettes/recette.php/ )
Et souvent ils essuient la rebuffade de leurs promesses traîtresses, telle Roxanne, qui a invité ses parents à l’école pour l’entendre jouer du violon dans le cadre d’une fête de Noël.
Ils n’ont pas répondu à son invitation. Sur le chemin du retour à la maison, elle s’est arrêtée dans la neige pour jouer dans la rue alors que sa mère l’a vue par la fenêtre.
Ces enfants mènent des vies tristes à mourir. C’est d’ailleurs la mort dans l’âme que se termine ce beau roman. Empathique et déchirant, il traduit une urbanité avec des mots empruntés à la rue sans empêcher la poésie de surgir en rythme syncopé comme un rap. Une poésie de l’urgence pour donner une voix aux enfants qui n’osent se plaindre. La cinéaste romancière reprend en somme la thématique de son film Le Ring, mettant en vedette un enfant du même milieu qui aspirait à devenir catcheur.
Chroniques de l'autre moitié
Voici des portraits d’enfants qui n’ont pas tirés la bonne carte au jeu de la vie. Leurs parents sont démunis. Des pères violents. Des mères putains. Et tout autour, le décor triste du quartier Hochelaga-Maisonneuve.
Certains chapitres s’apparent à la poésie contemporaine plutôt qu’au roman. L’écriture est saccadée. Des phrases courtes, parfois seulement quelques mots.
« Roxane ouvre la porte sur l’hiver et court dedans. Le violon, comme un prolongement de son corps, à sa main reste vissé. Roxane ne veut pas se noyer. Des flocons rouges tombent sur Montréal. La ville saigne. »
L’auteur se garde bien de nous offrir un univers strictement glauque et sans espoir. Ses enfants ont le coeur à se battre et s’accrochent à de menus détails qui font oublier leur infortune, même si ce n’est qu’une vue sur le fleuve. Mais, à l’image du parcours des personnages, la trame du livre demeure bien mince et ne mène vers rien.
La tristesse infinie et le désespoir en trois-D
Ce récit relate brutalement, dans l’un des quartiers les plus pauvres du Canada, l’histoire de grands dénuements transgénérationnels. Ainsi, dans les bas-fonds de l’arrondissement d’Hochelaga-Maisonneuve, telle une tradition, vivent des événements extrêmement pénibles et douloureux moralement, Kevin, Roxanne et Mélissa, prépubères. Parmi une confusion de rôles, enfants et parents, des personnages en plein désarroi, blessés par la vie, ne peuvent s’appuyer que sur la détresse de l’autre pour s’évaporer de leur carcan de calamité.
D’abord, dans « un coin de la cour d’école […] Kévin se bat la rage au ventre pour tout ce qu’il n’est pas. » Un certain soir, il s’apaise. Il abrie son père affligé par une existence remplie d’épreuves avant de se lover près de lui. Ensuite, Roxanne, pendant que sa mère lui hurle de la protéger des coups de son conjoint, écoute toujours plus fort Chostakovitch. Le lendemain, à l’épicerie du coin, elle achète son petit-déjeuner: un May West; et règle son emplette avec les bouteilles de bière vides laissées après la bagarre. Elle traîne également son malheur devant un groupe d’alcooliques anonymes et délivre à son géniteur son diplôme d’abstinence « Elle se sent si forte lui si petit.» Puis, sans adulte à la maison, Mélissa, ses deux jeunes frères qui pâtissent avec elle, suit les traces de sa mère en payant en nature le loyer.
Les phrases courtes, le niveau de langue des personnages et de la narratrice donnent davantage l’impression de faits réels plutôt que fictifs. Les nombreuses figures de style, entre autres plusieurs métaphores, atténuent la lourdeur du roman. Sans apitoiement excessif, l’auteur, avec ses mots, chamboule les sentiments du lecteur, l’amène à percevoir, ressentir une infime partie de l’abattement et de la peine de ces gens infortunés. Au nom des parents, ces ex-enfants, de ces trois préadolescents et de leurs futures descendances, elle lance un cri sourd de ralliement contre la pauvreté démesurée et souligne la bassesse de la société à tolérer sans cesse ces situations.
Forums: Je voudrais qu'on m'efface
Il n’y a pas encore de discussion autour de Je voudrais qu'on m'efface.
Ajouter une critique éclair
Commander chez amazon
Nous aurons une commission !
Mais faire vivre les libraires indépendants est important aussi
La note :
Moyenne des notes : (basée sur 4 avis)
Cote pondérée : (20 577ème position).
Visites : 2 212
Roman social
La réalisatrice du film “Le ring” attaque ici son premier roman. Elle y aborde encore ce thème qu’elle connaît bien. les enfants négligés d’Hochelaga-Maisonneuve.
Roxane, Kevin et Mélissa vivent tous les trois dans le même bloc. Ils partagent aussi la même classe “d’orthos” à l’école du quartier. Chacun à sa manière, ils se débattent dans la misère qui fait leur quotidien. Roxane s’évade à la bibliothèque pour oublier les beuveries de sa mère; Kevin se défoule sur ses jeux vidéo après l’école; Mélissa fait ce qu’elle peut pour cacher à la DPJ qu’elle n’a plus personne pour s’occuper d’elle et de ses petits frères.
C’est un roman écrit en langue parlée, pour ne pas dire en joual. Le langage ajoute encore de l’authenticité au propos; sous la plume de l’auteure, les personnages, les dialogues et le quartier en général prennent vie pour le lecteur. L’auteure dénonce une réalité qui existe et dont on n’entend pas assez parler, et elle le fait de façon habile. On les plaint, ces enfants, mais on plaint aussi leurs parents. Il n’y a pas de coupable dans ce livre, si ce n’est de la misère et de la pauvreté qui semblent se transmettre de génération en génération.
Mais il y a tout de même un bémol. On nous annonce un roman sans pathos, mais je ne suis pas tout à fait d’accord avec ce fait. Certaines scènes semblent mises en place expressément pour émouvoir le lecteur, ce qui m’a dérangée un peu. À certains moments, j’aurais préféré que l’auteure s’en tienne au minimum. La misère est déjà triste, il n’y a nul besoin de zoomer sur la souffrance.
La tristesse du regard des enfants de la détresse est un métalangage qu’interprète Anaïs Barbeau-Lavalette avec les mots bafoués d’une vie « ben mal emmanchée». Mal fichue, dirait-on de l’autre côté de la grande mare.
Sans les juger et sans susciter la pitié, Anaïs Barbeau-Lavalette décrit tout simplement le quotidien de petits Montréalais de l’arrondissement Hochelaga, qui fréquentent une « classe d’orthos » composée par des élèves qui ont soi-disant des troubles d’apprentissage. Des TA qui cherchent l’ivresse de vivre malgré la rudesse de leur existence. Ce ne sont pas les enfants rois des familles de l’aisance, ce sont ceux de la résilience. Ils portent sur leurs frêles épaules des responsabilités d’adultes. Ils sont presque les parents de leurs géniteurs.
Le seul expédient pour survivre reste la prostitution. La situation creuse une distance entre les génitrices et leur progéniture. C’est d’autant plus difficile lorsque, chaque jour pour se rendre à l’école, il faut franchir la barrière qu’elles érigent dans la rue Ontario afin de relever le client potentiel. Ce ne sont pas des mères dénaturées. Elles ont épuisé toutes leurs ressources. Pourtant, elles aimeraient bien être à la maison pour cuisiner le fameux pâté chinois pour leurs enfants qu’un rien met en liesse.
(recettes.qc.ca/recettes/recette.php/ )
Et souvent ils essuient la rebuffade de leurs promesses traîtresses, telle Roxanne, qui a invité ses parents à l’école pour l’entendre jouer du violon dans le cadre d’une fête de Noël. Ils n’ont pas répondu à son invitation. Sur le chemin du retour à la maison, elle s’est arrêtée dans la neige pour jouer dans la rue alors que sa mère l’a vue par la fenêtre.
Ces enfants mènent des vies tristes à mourir. C’est d’ailleurs la mort dans l’âme que se termine ce beau roman. Empathique et déchirant, il traduit une urbanité avec des mots empruntés à la rue sans empêcher la poésie de surgir en rythme syncopé comme un rap. Une poésie de l’urgence pour donner une voix aux enfants qui n’osent se plaindre. La cinéaste romancière reprend en somme la thématique de son film Le Ring, mettant en vedette un enfant du même milieu qui aspirait à devenir catcheur.
Chroniques de l'autre moitié
Voici des portraits d’enfants qui n’ont pas tirés la bonne carte au jeu de la vie. Leurs parents sont démunis. Des pères violents. Des mères putains. Et tout autour, le décor triste du quartier Hochelaga-Maisonneuve.
Certains chapitres s’apparent à la poésie contemporaine plutôt qu’au roman. L’écriture est saccadée. Des phrases courtes, parfois seulement quelques mots.
« Roxane ouvre la porte sur l’hiver et court dedans. Le violon, comme un prolongement de son corps, à sa main reste vissé. Roxane ne veut pas se noyer. Des flocons rouges tombent sur Montréal. La ville saigne. »
L’auteur se garde bien de nous offrir un univers strictement glauque et sans espoir. Ses enfants ont le coeur à se battre et s’accrochent à de menus détails qui font oublier leur infortune, même si ce n’est qu’une vue sur le fleuve. Mais, à l’image du parcours des personnages, la trame du livre demeure bien mince et ne mène vers rien.
La tristesse infinie et le désespoir en trois-D
Ce récit relate brutalement, dans l’un des quartiers les plus pauvres du Canada, l’histoire de grands dénuements transgénérationnels. Ainsi, dans les bas-fonds de l’arrondissement d’Hochelaga-Maisonneuve, telle une tradition, vivent des événements extrêmement pénibles et douloureux moralement, Kevin, Roxanne et Mélissa, prépubères. Parmi une confusion de rôles, enfants et parents, des personnages en plein désarroi, blessés par la vie, ne peuvent s’appuyer que sur la détresse de l’autre pour s’évaporer de leur carcan de calamité.
D’abord, dans « un coin de la cour d’école […] Kévin se bat la rage au ventre pour tout ce qu’il n’est pas. » Un certain soir, il s’apaise. Il abrie son père affligé par une existence remplie d’épreuves avant de se lover près de lui. Ensuite, Roxanne, pendant que sa mère lui hurle de la protéger des coups de son conjoint, écoute toujours plus fort Chostakovitch. Le lendemain, à l’épicerie du coin, elle achète son petit-déjeuner: un May West; et règle son emplette avec les bouteilles de bière vides laissées après la bagarre. Elle traîne également son malheur devant un groupe d’alcooliques anonymes et délivre à son géniteur son diplôme d’abstinence « Elle se sent si forte lui si petit.» Puis, sans adulte à la maison, Mélissa, ses deux jeunes frères qui pâtissent avec elle, suit les traces de sa mère en payant en nature le loyer.
Les phrases courtes, le niveau de langue des personnages et de la narratrice donnent davantage l’impression de faits réels plutôt que fictifs. Les nombreuses figures de style, entre autres plusieurs métaphores, atténuent la lourdeur du roman. Sans apitoiement excessif, l’auteur, avec ses mots, chamboule les sentiments du lecteur, l’amène à percevoir, ressentir une infime partie de l’abattement et de la peine de ces gens infortunés. Au nom des parents, ces ex-enfants, de ces trois préadolescents et de leurs futures descendances, elle lance un cri sourd de ralliement contre la pauvreté démesurée et souligne la bassesse de la société à tolérer sans cesse ces situations.
Forums: Je voudrais qu'on m'efface
Il n’y a pas encore de discussion autour de Je voudrais qu'on m'efface.
Ajouter une critique éclair
Commander chez amazon
Nous aurons une commission !
Mais faire vivre les libraires indépendants est important aussi





 Introduction en philosophie dissertation writing
Introduction en philosophie dissertation writing Cross cultural marketing dissertation proposal
Cross cultural marketing dissertation proposal Mildred montag doctoral dissertation proposal sample
Mildred montag doctoral dissertation proposal sample Writing a masters level dissertation topics
Writing a masters level dissertation topics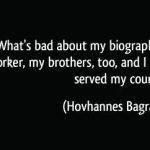 The ses and dissertations online umi
The ses and dissertations online umi